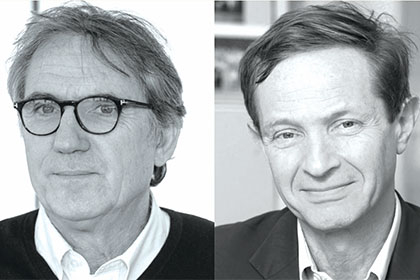Rien d’étonnant : elle est déjà largement utilisée dans l’industrie (notamment pour le raffinage du pétrole, la production de l’ammoniac et des engrais, la synthèse du méthanol), à hauteur d’un million de tonnes par an en France et de 10 millions en Europe, et sa combustion ne produit pas de dioxyde de carbone (CO2), comme le fait celle des hydrocarbures fossiles. De sorte qu’un peu partout en Europe et dans le monde fleurissent des scénarios de transition énergétique impliquant une consommation et donc une production massives d’hydrogène, souvent irréalistes, et des investissements financiers considérables (c’est le cas par exemple du programme France 2030). L’hydrogène serait ainsi la solution miracle pour décarboner tout à la fois les transports, routier, maritime et aérien, l’industrie et le chauffage de l’habitat et du tertiaire, c’est-à-dire les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre.
Dans son rapport « L’hydrogène, aujourd’hui et demain », rendu public le 21 mai 2024, l’Académie des Sciences s’attache d’abord à rappeler un certain nombre de limitations à la production et à l’usage de l’hydrogène. Celles-ci expliquent en partie pourquoi l’hydrogène n’est pas, en réalité, cette solution miracle. Son déploiement futur, d’une part, nécessite encore de la recherche, scientifique et technologique, et des innovations et, d’autre part, implique des arbitrages plus stricts dans ses usages.
La première limitation est liée au fait que l’hydrogène n’est pas une source d’énergie. C’est un vecteur énergétique dont la production est très consommatrice d’énergie. Aujourd’hui, cette production est faite à partir d’hydrocarbures fossiles (gaz naturel), et elle s’accompagne d’émissions importantes de CO2. Ce procédé, qui conduit à de l’hydrogène appelé « gris », désormais proscrit, doit être remplacé. L’hydrogène auquel les scénarios énergétiques de demain aspirent c’est de l’hydrogène, dit « vert », produit par électrolyse de l’eau (dans un dispositif appelé électrolyseur). Parce qu’il utilise de l’énergie électrique bas-carbone (nucléaire, éolienne ou solaire) et qu’il ne forme que de l’oxygène comme sous-produit de la réaction de décomposition de l’eau, ce procédé de synthèse est donc vertueux du point de vue de son impact sur le climat. La France est bien placée pour jouer un rôle dans le développement d’une économie de l’hydrogène, car elle est un des rares pays dans le monde à disposer d’une production d’électricité très décarbonée, grâce notamment à ses réacteurs nucléaires et ses barrages. Cependant, ce procédé d’électrolyse de l’eau est bien plus énergivore que le procédé actuel (la production du million de tonnes actuelles en France consommerait environ l’énergie fournie chaque année par 5 réacteurs nucléaires EPR du type de celui de Flamanville). Le déploiement massif de l’hydrogène vert va donc nécessiter – le rapport de l’Académie le rappelle avec force – la mise en place de nouvelles capacités de production électrique bas-carbone ainsi que des capacités d’électrolyseurs à une échelle importante, et il faut constater que, partout dans le monde, on est encore loin du compte.
La seconde limitation est liée au coût de production et donc au prix de cet hydrogène vert, trois à quatre fois plus élevé que celui de l’hydrogène gris, parce que les électrolyseurs eux-mêmes sont chers, ont des durées de vie limitées, fonctionnent avec des efficacités énergétiques et des stabilités encore insuffisantes, et que l’électricité est chère. De fait, la demande en hydrogène vert est atone, démobilisant les producteurs, malgré les subventions massives visant à promouvoir cette filière.
La troisième limitation est liée aux propriétés physiques et chimiques propres de la molécule d’hydrogène qui rendent la maitrise de son stockage, de son transfert et de son transport beaucoup plus complexe. Cela nécessite par exemple sa transformation, malheureusement énergivore, de l’état gazeux naturel, donc de trop faible densité énergétique volumique, à l’état liquide à très basse température, la mise au point de matériaux permettant de fixer réversiblement des quantités importantes d’hydrogène mais qui restent à découvrir, et l’élaboration de réservoirs spécifiques. Enfin, en raison de sa petite taille, l’hydrogène peut s’échapper plus facilement que toutes les molécules de taille plus grande (comme celle du méthane) des réservoirs dans lesquels il est stocké. Sa grande réactivité avec l’oxygène de l’air (énergie d’inflammation plus faible et des limites d’inflammabilité plus larges que celles de tous les autres gaz combustibles) peut plus facilement conduire à des incendies, des explosions et, dans des situations confinées, à une transition vers la détonation. Ceci fait de la question de la maitrise de la sécurité un enjeu majeur de l’avènement d’une économie de l’hydrogène, même si aujourd’hui, comme on l’a dit, des quantités importantes d’hydrogène sont utilisées en milieu industriel, mais justement dans un cadre où les protocoles d’utilisation sont très règlementés.
Sur la base de ces réalités physiques et économiques incontournables, l’Académie conclut son rapport en faisant un certain nombre de recommandations.
En premier lieu, elle exprime sa conviction qu’une partie de la solution réside dans la connaissance, la recherche, aussi bien fondamentale, technologique qu’industrielle, seules à même d’apporter des améliorations indispensables, par exemple aux rendements et à la stabilité des électrolyseurs et des piles à hydrogène. Le besoin de recherche concerne également la technologie des réservoirs, leur résistance et leur poids, les capacités de stockage de matériaux, les procédés d’hydrogénation du CO2, pour produire des carburants liquides, alternatifs au pétrole, dont certains transports lourds ne pourront se passer et qui sont encore aujourd’hui beaucoup trop chers, etc. Cette recherche doit aussi s’appliquer à l’exploration et à l’exploitation éventuelle de l’hydrogène naturel ou natif, qui ferait passer l’hydrogène d’un statut de vecteur énergétique à celui de source d’énergie, puisqu’il ne serait pas alors produit au prix d’une dépense d’électricité ou d’énergie fossile. Si elle se réjouit qu’une telle ressource existe, y compris en France, l’Académie avertit qu’on est encore loin d’avoir une idée précise des gisements réels et de la capacité à les exploiter et recommande de soutenir les travaux exploratoires permettant d’en savoir plus.
Dans sa seconde recommandation, l’Académie invite les pouvoirs publics et le monde industriel à redéfinir les objectifs de production et de consommation d’hydrogène vert. Certains scénarios, et c’est le cas de la stratégie européenne en matière d’hydrogène, font appel à des niveaux irréalistes, incompatibles avec les capacités de production électrique et le niveau accessible de capacités d’électrolyseurs. Ces niveaux se traduiraient par des dépendances nouvelles fortes, par nécessité d’importations d’hydrogène vert, mais sans savoir pour le moment d’où il viendrait, et d’électrolyseurs dont le marché serait, comme il l’est aujourd’hui, dominé par la Chine et les Etats-Unis.
L’Académie invite donc à procéder à des arbitrages stricts en définissant des priorités quant à l’utilisation de l’hydrogène. Il parait raisonnable de proposer que l’hydrogène vert soit d’abord utilisé dans ses applications industrielles. D’une part, pour remplacer l’hydrogène gris dans les procédés industriels où il est utilisé actuellement, à savoir, comme on l’a dit, le raffinage du pétrole, la synthèse de l’ammoniac et de molécules comme le méthanol. D’autre part, pour contribuer à la décarbonation des procédés industriels aujourd’hui les plus émetteurs de CO2, comme la production d’acier et de ciment, difficiles à électrifier. Ces choix sont destinés à limiter l’usage d’hydrogène vert à un niveau raisonnable et accessible, mais ambitieux, qui ne pourra dépasser, pour un pays comme la France, 1 à 2 millions de tonnes à l’horizon 2050. Un peu au-dessus du niveau actuel. Mais il ne sera plus gris mais vert. ■