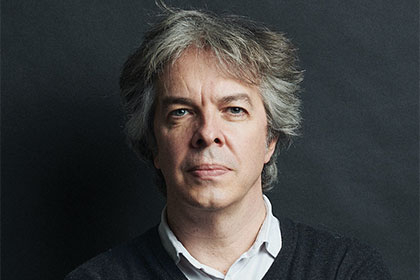Que signifie le concept d’une seule santé ?
Les maladies infectieuses, conséquences de l’apparition ou réapparition d’agents pathogènes partagés entre l’homme et l’animal, comme la COVID-19, représentent de manière caricaturale ce concept. Trois dimensions sont interdépendantes : l’environnement partagé, interactions entre l’homme et l’animal ou phénomènes plus complexes dûs à la diminution de la biodiversité ; la sécurité alimentaire impliquant par exemple les modifications des pratiques agricoles ; le partage des médicaments et des interventions.
Et en termes de santé publique ?
Avec une option « One Health », les ressources financières pourraient être allouées de façon plus optimale afin de traiter les coûts propres que ces pathologies génèrent. Vacciner tous les chiens d’une même région contre la rage au lieu de dépenser des sommes considérables pour la prophylaxie post-exposition par exemple.
La pandémie COVID-19 a cruellement pointé les insuffisances de notre préparation mais attention, il y a d’autres problématiques d’importance : la résistance aux agents antiinfectieux, et d’abord aux antibiotiques, liée aux soins donnés aux animaux d’élevage. Et également la prévention de potentielles attaques bioterroristes pouvant utiliser les agents infectieux comme vecteurs.
Quels sont les objectifs du DIM One Health 2.0 ?
Il vise à financer des projets innovants d’équipes dont l’objet est d’identifier les évènements pouvant conduire à l’émergence ou la dissémination d’un agent infectieux dans différents milieux. Ce DIM s’impliquera à évaluer les risques infectieux tout en proposant des solutions opérationnelles, applicables à la Région et au-delà. Il s’appuie pour cela sur la quasi totalité des partenaires travaillant dans le champ des maladies infectieuses de la région que ce soit sur des aspects de médecine humaine ou vétérinaire avec des champs disciplinaires couvrant les aspects de sciences biologiques, environnementales, mathématiques, médicales, et sociales. Les objectifs finaux étant, outre le financement de projets sur la thématique, la création d’un réseau visible et facilement identifiable sur celle-ci et l’accroissement des interactions structures académiques et privées existant déjà sur le territoire francilien.
En quoi le DIM a-t-il sa pertinence en Île-de-France ?
Au-delà de ses atouts géographiques, l’Île-de-France bénéficie de dispositifs de recherche exceptionnels dans le domaine.
Une pathologie tropicale peut diffuser en zone tempérée, voire s’adapter et devenir pérenne. Un site comme l’aéroport de Roissy peut être un point d’introduction d’agents pathogènes. Ces derniers lorsqu’ils sont transmis par les aliments sont toujours à l’origine de toxi-infections alimentaires. Mais les animaux de compagnie, les pigeons et d’autres espèces animales régionales peuvent être aussi des vecteurs de pathologies infectieuses chez l’Homme. Les interactions entre ces dernières et la précarité sont préoccupantes. Enfin, les JO sont aussi un événement à risques à surveiller.
Ce réseau a un caractère structurant pour la communauté scientifique francilienne. Un Institut One Health en infectiologie est en réflexion pour associer plus étroitement infectiologie humaine et vétérinaire tout en associant les agences travaillant au niveau des risques environnementaux. Il renforcera le tissu scientifique et économique de la région.
Quelques exemples d’actions concrètes ?
Prenons l’exemple des maladies à tiques. Nous avons financé un projet de recherche de l’ANSES visant à la taxonomie d’une espèce de tiques d’Afrique tropicale afin d’anticiper de potentielles émergences de maladies à tiques en Europe. La question de l’émergence de celles-ci sera également à l’agenda de notre prochain séminaire dédié à l’impact des changements climatiques sur les maladies vectorielles infectieuses. ■