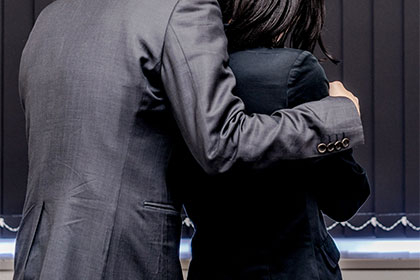En 2022, 230 000 femmes ont été victimes de viols, tentatives de viol et/ou agressions sexuelles en France, selon les données du ministère de l’Intérieur. Face à une « criminalité sexuelle qui ne recule pas » et « un climat d’impunité qui perdure », « il est temps d’agir » lancent les deux députées qui préconisent dans leur rapport d’inclure la notion de « non-consentement dans la définition pénale du viol ». Aujourd’hui, l’article 222-23 du code pénal définit le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ». Si le rapport entend bien conserver ces quatre critères - violence, contrainte, menace, surprise -, les élues souhaitent ajouter la notion de non-consentement en intégrant dans la définition pénale les « cas de sidération, de contrôle coercitif ou d’exploitation de situations de vulnérabilités » qui ne sont à l’heure actuelle « pas explicitement couverts par la loi » expliquent-elles. « La nouvelle définition doit préciser que le consentement est spécifique, doit être donné librement et peut être retiré à tout moment » ajoutent-elles. « J’y suis favorable » a déclaré sur France 2 la ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes. « On a des magistrats qui nous interpellent en nous disant qu’aujourd’hui, il y a encore des situations qui leur échappent, parce que ce n’est pas suffisamment précis, défini » a reconnu Aurore Bergé. « On a besoin que ce débat existe dans l’ensemble de la société, que cette culture existe dans l’ensemble de la société, or on voit que ce n’est pas encore le cas » a-t-elle encore souligné.
Pour Véronique Riotton et Marie-Charlotte Garin, « faute d’une définition claire », le « consentement est souvent instrumentalisé par les agresseurs (’Je ne pouvais pas savoir’, ’Elle n’a rien dit’), ce qui alimente les stéréotypes sur le viol, complique les dépôts de plainte et engendre de nombreux classements sans suite, au détriment des victimes » sans compter que la définition actuelle contribue, jugent-elles, « au maintien de préjugés sociétaux sur ce qu’est une ’ bonne’ victime (qui résiste, se débat, est exemplaire dans son comportement), un ’vrai’ viol (avec violence et contrainte, par un individu monstrueux et/ou étranger) ». Un état de fait et du droit qui n’est plus acceptable, « alors que s’est clos » le procès des viols de Mazan « qui aura été par bien des égards le procès de la culture du viol ».
Si Emmanuel Macron s’est montré favorable à cette évolution de la définition pénale du viol, l’idée ne fait cependant pas l’unanimité en France. Ses opposants craignent un renversement de la charge de la preuve quand d’autres s’inquiètent d’un « glissement vers une contractualisation des rapports sexuels ». Les associations féministes sont aussi divisées entre celles qui estiment que la prise en compte de la notion du consentement ne serait que l’application de la Convention d’Istanbul, ratifiée en 2014 par la France et celles qui s’inquiètent de la non prise en compte de situations dans lesquelles le consentement est extorqué et contraint.
Reconnaissant que la réforme « n’aura pas l’effet d’une baguette magique sur les violences sexuelles », les élues insistent fermement pour rappeler « que le viol ne peut pas être uniquement caractérisé par la violence, la menace, la contrainte et la surprise, parce que cela laisse des centaines de milliers de victimes sur le côté, et ça, ce n’est pas acceptable ». Pour Véronique Riotton et Marie-Charlotte Garin, cela ne doit évidemment pas non plus « nous dispenser d’un plan global, ambitieux et financé, de lutte contre les violences sexuelles et la culture du viol ». Une proposition de loi reprenant les conclusions du rapport pourrait être inscrite à l’ordre du jour d’ici mars. ■