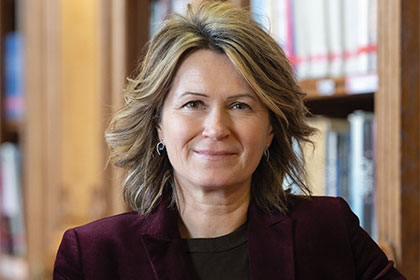Les spécificités du contexte – sortie d’inflation des matières premières, crise agricole, tensions sur le pouvoir d’achat, reconfiguration du secteur de la grande distribution –ont conduit à formuler des recommandations en vue d’évolutions du cadre juridique.
Les deux principales limites du cadre Egalim actuel, sur le volet négociations commerciales, tiennent autant à son application lacunaire (notamment à la contractualisation amont), qu’à des contournements délibérés (les centrales d’achats internationales).
D’autres mécanismes fonctionnent plutôt bien mais pourraient être améliorés.
Il faut rappeler que les mécanismes prévus en matière de relations commerciales ne sont pas d’une grande simplicité et que certains dispositifs sont applicables depuis moins d’un an.
La contractualisation écrite, généralisée par la loi Egalim 2 est faiblement appliquée. La quasi-totalité des filières animales y sont soumises mais elle n’est véritablement ancrée que dans la filière laitière. Les interprofessions doivent poursuivre leurs efforts d’accompagnement et de structuration. La DGCCRF doit aussi partager les résultats de ses contrôles pour dresser un état des lieux et faire avancer la contractualisation. Enfin, plusieurs filières ont exprimé récemment leur souhait d’entrer dans le champ de la contractualisation obligatoire alors qu’elles en sont, à ce jour, exemptées.
Les indicateurs de référence sont peu ou mal appliqués. Leur intérêt est pourtant salué : ils fournissent une base de discussion fiable et objective pour les négociations entre organisations de producteurs et entreprises. Mais de nombreux indicateurs ne sont pas publiés par les interprofessions, faute d’accord entre les acteurs, ou pas mis à jour régulièrement. Sans indicateurs de référence, le risque que les acteurs cherchent à imposer des indicateurs qui ne sont pas représentatifs des structures de coûts est réel. Dans ce cadre et afin de sécuriser les producteurs face à la volatilité des prix, un poids prépondérant pourrait être donné aux indicateurs de coûts de production dans les formules de détermination et de révision du prix.
Au-delà de l’application imparfaite d’Egalim, il faut souligner les contournements délibérés des centrales d’achats basées à l’étranger. Elles sont aussi parfois le support de pratiques commerciales abusives. Environ 20 % en valeur et jusqu’à 50 % en volume des produits commercialisés par la grande distribution pourrait être négociés à l’étranger. Ces centrales ne se limitent plus aux multinationales mais intègrent aussi des PME et ETI.
Les centrales de services se développent aussi. Certains services commerciaux – ristournes, opérations publicitaires ciblées etc. – ne sont pas pris en compte dans la construction du tarif, se superposent à des services déjà payés au niveau national voire sont fictifs et s’apparentent alors à un droit d’entrée en négociations sans contrepartie économique réelle.
L’essor de ces centrales d’achat et de services s’explique de deux manières :
• Les distributeurs considèrent que ceux qui n’y ont pas recours subissent un désavantage concurrentiel.
• Ces « mauvaises » pratiques ne sont pas systématiquement sanctionnées. Les autorités françaises ont adopté une position de prudence à la suite de contentieux et de conflits de compétences. Nous appelons à des sanctions systématiques en cas d’infractions constatées. Nous recommandons également la conclusion d’une charte des industriels et des distributeurs pour exclure les produits à forte composante de matière première agricole des négociations à l’international.
A l’amont, il est souhaitable que le fournisseur de la grande distribution ait conclu son contrat avec l’amont agricole avant d’entrer en négociations avec les enseignes, afin de disposer du coût de la MPA et des indicateurs associés. Ce séquençage matérialise la construction du prix « marche en avant ». Pour la concrétiser, nous préconisons que l’industriel mentionne, dans ses conditions générales de vente, les indicateurs qui ont été utilisés à l’amont pour déterminer le prix de la matière première agricole.
Concernant l’aval, la date « butoir » annuelle de conclusion des conventions entre industriels et distributeurs, principal jalon des négociations commerciales, ne doit pas être remise en cause. Pour autant, raccourcir la négociation d’un mois permettrait d’alléger les ressources qu’une entreprise dédie à ces négociations commerciales. Cette date devrait aussi être la même pour tout le monde. En 2024, les PME qui ont conclu leurs contrats au 15 janvier n’ont pas été mieux traitées que les autres. Pour celles qui le veulent, la négociation anticipée, avant les grands groupes, est déjà formalisée au moyen de chartes avec la grande distribution : cela doit être poursuivi pour celles qui le souhaitent.
Au sein des contrats aval, les clauses de révision automatique du prix en fonction de l’évolution de la matière première agricole ont été rendues obligatoires par la loi Egalim 2. La période de volatilité des prix que nous venons de connaître a montré leur intérêt. Leur principal défaut est qu’elles font parfois l’objet d’une « négociation dans la négociation » visant des seuils élevés de déclenchement ou l’utilisation d’indicateurs non-représentatifs des prix d’achat réels des industriels. En conséquence, l’obligation d’insérer une clause de « renégociation », peu utilisée et source de confusion, pourrait être remplacée par une clause prenant en compte l’évolution du coût des matières premières industrielles comme l’énergie ou le transport.
L’encadrement des pénalités logistiques est une avancée notable des lois Egalim. Les déductions d’office des pénalités de la facture ont quasiment disparu. Il reste des progrès à accomplir concernant la preuve du préjudice et l’interprétation, parfois divergente entre distributeurs et fournisseurs, de l’assiette des pénalités et du taux que nous avons fixé en 2023, qui est un plafond et non un forfait.
Enfin, il est à déplorer l’absence d’évaluation du relèvement du seuil de revente à perte (SRP +10 %) mécanisme pivot d’Egalim, censé permettre le « ruissellement ». Inflationniste par essence (on estime le coût pour les consommateurs entre 600 et 800 millions par an, partis dans les caisses des distributeurs) ce dispositif n’a pas démontré son effet bénéfique « en cascade » sur la rémunération du producteur.
Il arrive à échéance en avril 2025. Chacun est bien conscient du piège du SRP+10 ! On ne peut ignorer ses effets inflationnistes pour le consommateur, l’absence de traçabilité par rapport aux objectifs fixés dans la loi et le fait que ces sommes ont bel et bien été encaissées par les distributeurs. Pour autant, sa suppression pourrait avoir des conséquences pour les agriculteurs et les industriels puisqu’elle relancerait la guerre des prix entre distributeurs.
C’est pourquoi, nous préconisons en urgence une véritable évaluation et dans l’attente, une prolongation et non une pérennisation du dispositif.
En parallèle à l’absence d’information sur l’utilisation du surplus issu du SRP + 10 %, se pose la question du financement de la publicité sur le prix des denrées alimentaires. Elle a été considérablement accrue : alors qu’en 2011, les trois premiers annonceurs français étaient Renault, Orange et SFR. En 2023, le trio de tête est préempté par les grands distributeurs. Nous recommandons donc que soient évalués les effets de la publicité comparative sur la valorisation de la MPA ainsi que les possibilités d’encadrer cette publicité comparative.
Pour conclure, nous faisons le constat alarmant d’un décrochage de la ferme France dans les rayons, concomitant à deux phénomènes particulièrement préoccupants : l’affaiblissement de la sanctuarisation de la matière première agricole et la généralisation des centrales d’achat internationales qui contournent les lois « Egalim ».
Il faut lutter contre la tentation d’un bouleversement du cadre des négociations commerciales et d’une complexification à l’heure où les acteurs sont en quête de stabilité juridique. Nos recommandations visent avant tout à mieux appliquer et fluidifier la logique « Egalim » de construction du prix « marche en avant ». ■
Les lois Egalim, “un criant échec” selon l’UFC-Que Choisir
La disposition visant à obliger la grande distribution à relever de 10 % le seuil de revente à perte pour les denrées alimentaires transformées n’a pas eu l’effet escompté selon l’association de consommateur qui juge même qu’elle aurait eu un effet contraire aux objectifs affichés. Au détriment du consommateur et des agriculteurs. « Ce n’est absolument pas au bénéfice de nos agriculteurs que les consommateurs ont subi une inflation supplémentaire – reconnue aussi bien par le monde agricole et industriel, que par les parlementaires – représentant entre 470 millions d’euros et 1 milliard d’euros par an selon les estimations, soit au total plusieurs milliards d’euros depuis son entrée en vigueur il y a près de 6 ans » dénonce l’association.
Au moment de la mise en œuvre du dispositif - qui a été prolongé jusqu’au 15 avril -, pour justifier la marge minimale de 10 % garantie à la grande distribution, il avait été largement expliqué que par effet de « ruissellement » les sommes supplémentaires prélevées sur les consommateurs allaient permettre une revalorisation des prix d’achat consentis par les enseignes aux industriels, ces derniers étant ensuite censés reverser ces sommes aux agriculteurs. Or, l’étude réalisée par l’UFC-Que Choisir montre qu’en réalité le revenu agricole a baissé en 2019, année de la mise en œuvre du SRP+10, pour 3 filières étudiées (céréales, viande de porc et de bœuf) et stagné pour la filière laitière. UFC-Que choisir s’insurge aussi contre le détournement de la loi par la grande distribution, qui lorsqu’elle est sanctionnée n’écope que d’amendes ridicules. Dans un entretien aux Echos, la ministre de l’agriculture a assuré qu’une nouvelle loi serait prochainement préparée « afin d’éviter que tout le dispositif ne s’effondre ».